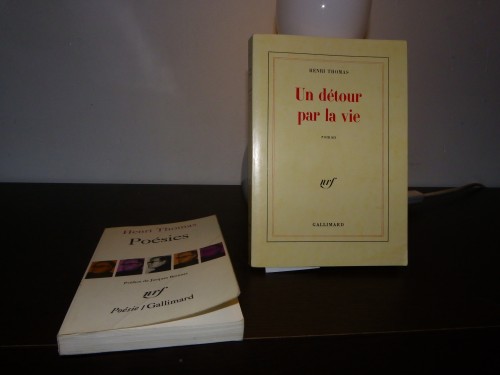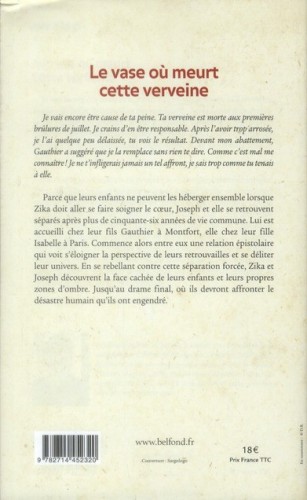 C'est un cadeau de noël. Parait-il que je l'avais mis sur ma liste. Je ne m'en souviens plus. Peut-être que j'avais été subjugué par le titre..le vase où meurt cette verveine (extrait d'un poème de Sully Pruhomme).
C'est un cadeau de noël. Parait-il que je l'avais mis sur ma liste. Je ne m'en souviens plus. Peut-être que j'avais été subjugué par le titre..le vase où meurt cette verveine (extrait d'un poème de Sully Pruhomme).
Pour des raisons de santé, Joseph et Zika, un couple de septuagénaires, doivent se séparer et quitter leur maison après cinquante huit ans de vie commune ininterrompue. Chacun est pris en charge par un des enfants. Commence alors une relation épistolaire où l'on se dit qu'on s'aime, qu'on se manque, on se rappelle les jours heureux, de la jeunesse, des enfants, ce qu'on n'a pas pas bien fait pour qu'ils soient si ingrats, et puis il y a la verveine dont Joseph doit s'occuper mais finalement elle meurt, symbolisant le dénouement de cette histoire familiale pas drôle (nouvelle variation sur le thème 'les familles sont des asiles de fous') somme toute très moderne.
Si l'histoire tient la route et donne à réfléchir sur la vieillesse et sa prise en charge, une fois de plus, j'ai été agacé par un roman épistolaire...deux êtres s'envoient des lettres, ce ne sont pas des fins lettrés (Joseph travaillait dans l'agriculture, je crois) et pourtant le style est impeccable, style d'écrivain en fait, et surtout, il n'y aucune différence entre les lettres sur la forme. On a tous son propre style, non ? Par ailleurs, afin d'informer le lecteur de certains événements ayant jalonnés leur vie (rencontre par exemple), l'auteur a dû faire dire a chacun des émissaires, des choses qu'ils savaient puisque les ayant vécu tous les deux. Cerise sur la gâteau : les lettres sont émaillées de dialogues dont le but est de retranscrire au mieux le quotidien de chacun.
C'est la raison pour laquelle, je ne suis pas fan des romans épistolaires. Ou on fait un roman épistolaire, et alors le narrateur doit vraiment se mettre dans la peau de celui qui écrit et abandonner son style propre( pas évident mais bon) soit on fait un roman tout court avec un narrateur extérieur au roman mais qui sait tout.
lecture : janvier 2013
folio n°3309, 117 pages
note : 2.5/5
à suivre : oh, Philippe Djian
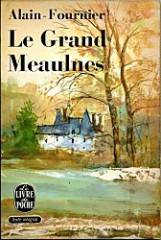 Je stipulais dans une précédente note que je n'avais pas ressenti les mêmes émotions lors de cette deuxième lecture que lors de la première il y a à peu près 25 ans. Car il y a quelque chose dans Le Grand Meaulnes qui ne parle qu'aux adolescents et pour l'adulte qui s'y plonge, le but ne peut être que se rappeler l'adolescent qu'il fut.
Je stipulais dans une précédente note que je n'avais pas ressenti les mêmes émotions lors de cette deuxième lecture que lors de la première il y a à peu près 25 ans. Car il y a quelque chose dans Le Grand Meaulnes qui ne parle qu'aux adolescents et pour l'adulte qui s'y plonge, le but ne peut être que se rappeler l'adolescent qu'il fut. 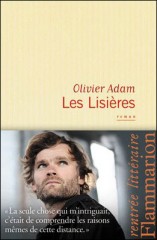 A la base, le roman devait s'appeler théorie des lisières. Je me demande si ce n'est pas parce qu'un autre gros roman de la rentrée s'appelle théorie de l'information (qui ne me fait pas du tout envie) que d'aucuns, l'éditeur ou l'auteur, ont décidé de changer le titre. Et puis, les théories de...c'est comme l'écologie, ça commence à bien faire. Il y a quelques années, on s'est tapé des éloges de en veux-tu en voilà, maintenant, ce sont des théories. Pourquoi pas, hein, moi aussi j'échaffaude des théories dans ma voiture (mais je ne les publie pas) mais ça fait quand même un peu présomptueux. Toujours est-il que c'est quand même quelque part une théorie que nous rapporte Olivier Adam dans ce roman autofictif (lui aussi y a sombré). Le narrateur, Paul Steiner ( ça claque) écrivain à succès de son état s'est retranché depuis quelques années en Bretagne où il coule des jours plutôt tristes depuis qu'il est séparé de sa femme et qu'il ne voit ses deux enfants que de temps en temps (d'émouvantes pages sont dédiées à la joie des retrouvailles, à l'amour plus fort que tout d'un père pour ses enfants). Il doit se rendre en région parisienne où il est né et a grandi pour rendre visite à sa mère, victime d'une mauvaise chute. Ce retour aux sources est l'occasion pour Paul de revenir sur ses années d'enfance dans cette petite ville périphérique. Il y retrouve des amis d'enfance qui pour beaucoup sont restés croupir dans ce no man's land pavillonaire qui le dégoute profondément tant il est laid et monotone. Le temps est venu de balancer sa science, sa théorie. Pourquoi se sent-il perpétuellement à côté de la fête ? Parce qu'il est un homme des lisières...lisières de la capitale dans un premier temps et lisières de la France ensuite en allant s'enterrer, ou s'emmerrer sur le littoral breton. Il est beaucoup question de cette France pavillonaire, de son mode de vie, de son vote, de ses aspirations. Paul, lui, a tout compris, il a embrassé le monde dans sa totalité, en a compris la complexité, il est donc de gauche et s'engueule gentiment avec son frère ainé, vétérinaire de droite et son père tenté par la blonde du fn. C'est intéressant à lire, c'est du brut de décoffrage. Paul vit en lisisères de tout. Il ne supporte pas le microcosme littéraire non plus, il ne supporte rien ce rabat-joie. Torturé de nature, il est touché par la Maladie et c'est lors de ce retour dans la maison de son enfance qu'il apprend par hasard un secret de famille qui a son sens explique ce manque qu'il ressent depuis son enfance.
A la base, le roman devait s'appeler théorie des lisières. Je me demande si ce n'est pas parce qu'un autre gros roman de la rentrée s'appelle théorie de l'information (qui ne me fait pas du tout envie) que d'aucuns, l'éditeur ou l'auteur, ont décidé de changer le titre. Et puis, les théories de...c'est comme l'écologie, ça commence à bien faire. Il y a quelques années, on s'est tapé des éloges de en veux-tu en voilà, maintenant, ce sont des théories. Pourquoi pas, hein, moi aussi j'échaffaude des théories dans ma voiture (mais je ne les publie pas) mais ça fait quand même un peu présomptueux. Toujours est-il que c'est quand même quelque part une théorie que nous rapporte Olivier Adam dans ce roman autofictif (lui aussi y a sombré). Le narrateur, Paul Steiner ( ça claque) écrivain à succès de son état s'est retranché depuis quelques années en Bretagne où il coule des jours plutôt tristes depuis qu'il est séparé de sa femme et qu'il ne voit ses deux enfants que de temps en temps (d'émouvantes pages sont dédiées à la joie des retrouvailles, à l'amour plus fort que tout d'un père pour ses enfants). Il doit se rendre en région parisienne où il est né et a grandi pour rendre visite à sa mère, victime d'une mauvaise chute. Ce retour aux sources est l'occasion pour Paul de revenir sur ses années d'enfance dans cette petite ville périphérique. Il y retrouve des amis d'enfance qui pour beaucoup sont restés croupir dans ce no man's land pavillonaire qui le dégoute profondément tant il est laid et monotone. Le temps est venu de balancer sa science, sa théorie. Pourquoi se sent-il perpétuellement à côté de la fête ? Parce qu'il est un homme des lisières...lisières de la capitale dans un premier temps et lisières de la France ensuite en allant s'enterrer, ou s'emmerrer sur le littoral breton. Il est beaucoup question de cette France pavillonaire, de son mode de vie, de son vote, de ses aspirations. Paul, lui, a tout compris, il a embrassé le monde dans sa totalité, en a compris la complexité, il est donc de gauche et s'engueule gentiment avec son frère ainé, vétérinaire de droite et son père tenté par la blonde du fn. C'est intéressant à lire, c'est du brut de décoffrage. Paul vit en lisisères de tout. Il ne supporte pas le microcosme littéraire non plus, il ne supporte rien ce rabat-joie. Torturé de nature, il est touché par la Maladie et c'est lors de ce retour dans la maison de son enfance qu'il apprend par hasard un secret de famille qui a son sens explique ce manque qu'il ressent depuis son enfance. 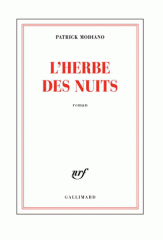

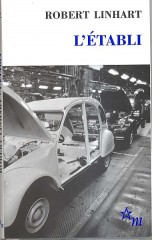

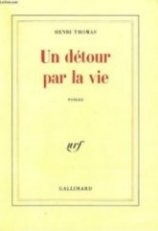 J’aurais tant aimé adorer cet écrivain que je suis déçu de devoir faire part de ma déception suite à la lecture de ce roman qui n’a de beau et d’original que le titre. Un détour par la vie, quand même, quoi ça promettait nan ? Gambetti, lui, évoluait dans extinction de Thomas Bernhard, ça en jette aussi, mais l’intérieur a tenu ses promesses et puis aujourd”hui, des mois après, extinction est toujours présent grâce à ce Gambetti, qui est devenu, en quelque sorte, l’agrégateur imaginaire de tous mes interlocuteurs et antagonistes.
J’aurais tant aimé adorer cet écrivain que je suis déçu de devoir faire part de ma déception suite à la lecture de ce roman qui n’a de beau et d’original que le titre. Un détour par la vie, quand même, quoi ça promettait nan ? Gambetti, lui, évoluait dans extinction de Thomas Bernhard, ça en jette aussi, mais l’intérieur a tenu ses promesses et puis aujourd”hui, des mois après, extinction est toujours présent grâce à ce Gambetti, qui est devenu, en quelque sorte, l’agrégateur imaginaire de tous mes interlocuteurs et antagonistes.